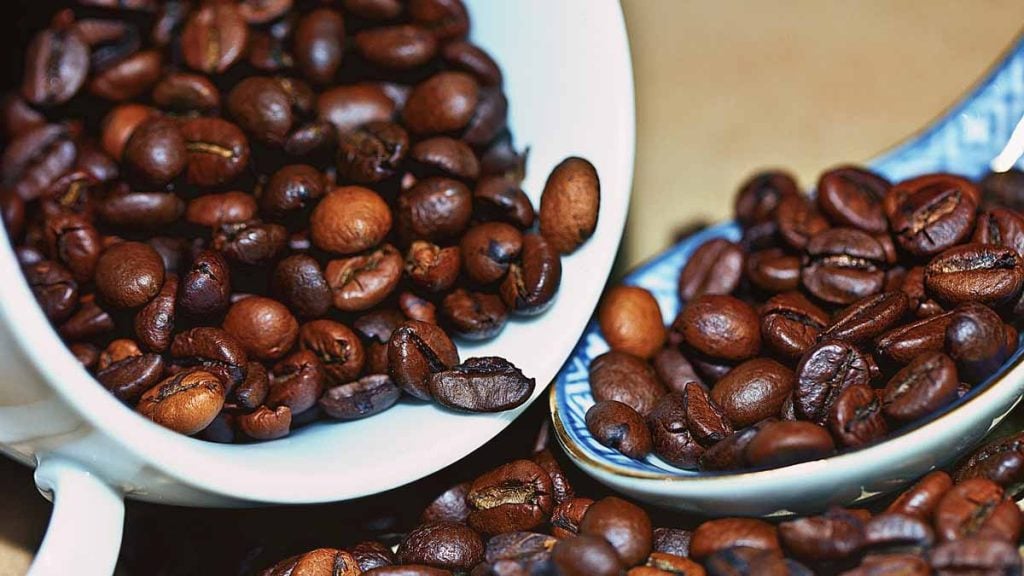La tasse du matin réveille, pourtant son effet exact interroge. Selon les travaux disponibles, le mode d’infusion, la quantité, le rythme et l’habitude peuvent influer sur certains marqueurs sanguins. Sans alarmer, ils invitent à peser la préparation et la dose au quotidien, puis à considérer son propre terrain. Derrière le rituel, une question persiste : café et cholestérol, quel lien réel ?
Ce que la science dit du café et du cholestérol
Une équipe norvégienne a suivi 21 083 adultes volontaires. Publiée dans OpenHeart, l’enquête a croisé un questionnaire sur le nombre de tasses de café bues chaque jour. Une prise de sang mesurait le cholestérol total. L’objectif est de relier les pratiques d’infusion, l’habitude et les profils biologiques, sans changer les routines.
Les résultats montrent une tendance. Le « bouilli » à piston élève le plus les taux, chez les femmes comme chez les hommes. L’instantané suit, avec une hausse plus modérée. Pour les autres méthodes, les écarts varient selon le sexe. Cela suggère une interaction entre type d’infusion, sensibilité et consommation.
Les auteurs notent qu’entre trois et cinq expressos par jour, l’augmentation devient significative, surtout chez les hommes. À l’inverse, avec six tasses ou plus de filtré, les taux sont notamment plus élevés que chez les hommes. Les analyses le confirment. Au-delà de 400 mg recommandés, d’autres risques peuvent se cumuler.
Pourquoi le café bouilli et l’expresso agissent différemment ?
La préparation change la donne. Sans filtre en papier, le bouilli à piston laisse passer des composés issus du café dans l’organisme. Cela peut influer notamment sur les marqueurs lipidiques. Le filtrage en retient une partie. Extraction, température, mouture et temps de contact modulent le profil final dans la tasse.
L’expresso, préparé sous pression et en court contact, concentre arômes et particules fines. Dans l’enquête, entre trois et cinq tasses quotidiennes, une hausse nette apparaît, plus marquée chez les hommes. Le signal varie aussi selon l’âge, la sensibilité et les habitudes alimentaires, le niveau d’activité et la qualité du sommeil.
L’instantané montre un effet plus modéré, réel, mais moindre que le bouilli. Avec les autres préparations, les écarts restent hétérogènes entre profils, notamment au quotidien. Cela rappelle l’importance de l’ensemble : type d’infusion, quantité bue et rythme de consommation. La dilution, la granulométrie et l’eau utilisée accentuent parfois les différences.
Interpréter prudemment et adapter ses habitudes personnelles
Les auteurs rappellent une limite majeure puisqu’il s’agit d’association, pas de preuve causale. Le plan d’étude repose sur des déclarations et des dosages biologiques ponctuels, avec des biais possibles résiduels. Activité, tabagisme, alcool, stress, sommeil et alimentation peuvent brouiller le signal. Les modèles statistiques cherchent à corriger ces facteurs.
Face à ces incertitudes, des choix simples aident. Le filtre en papier retient des molécules non désirées. Un rythme stable, des portions mesurées et une dose proche des 400 mg recommandés limitent les excès. Mieux vaut avancer par étapes, tester ses repères et s’appuyer sur un suivi médical si besoin.
Écouter ses marqueurs reste clé, c’est-à-dire, un bilan lipidique récent et des objectifs réalistes. En cas d’anomalie, discutez avec votre soignant pour ajuster infusion, quantité et fréquence. Si le sommeil est fragile, limitez le café en fin de journée. Privilégiez l’hydratation, échelonnez les prises et diversifiez vos boissons au quotidien.
Choisir sa préparation en tenant compte de son profil
Les données convergent vers une idée claire. La préparation et la dose comptent, la réaction individuelle aussi. Le bouilli à piston et l’expresso intensif s’accompagnent d’une hausse mesurable, tandis que le filtre en papier atténue certains effets. Gardez un œil sur vos repères, ajustez en souplesse. Faites du café un plaisir maîtrisé, intégré à une hygiène de vie cohérente.